Wilders, Meloni, Le Pen. Comment les hurlements vains alimentent le vote d’extrême droite.
 Après six mois de négociation, les Pays-Bas ont « enfin » un gouvernement. Mais il inclut le PVV, le Parti de la Liberté (sic) de Geert Wilders, représentant peroxydé d’une extrême droite néerlandaise qui associe xénophobie et mesures sociales.
Après six mois de négociation, les Pays-Bas ont « enfin » un gouvernement. Mais il inclut le PVV, le Parti de la Liberté (sic) de Geert Wilders, représentant peroxydé d’une extrême droite néerlandaise qui associe xénophobie et mesures sociales.
Les hurlements n’ont pas tardé. Au secours ! L’extrême droite gouverne un pays européen de plus ! Le fascisme est de retour ! Nous revivons les pires heures de l’histoire ! Faisant mine d’ignorer que, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quatre-vingts ans de démocratie ont imbibé la société, limitant malgré tout le potentiel de ces partis xénophobes. Les hurlements servent donc plus ceux qui les poussent qu’elle ne sert la lutte contre les extrémismes.
Bien sûr, on a le devoir de s’inquiéter et de s’alarmer de la montée des extrêmes en Europe et en particulier des identitaires de droite. Mais ça signifie qu’on a le devoir de comprendre. Et donc, de raisonner.
Il faudrait d’abord se redemander si l’on a, oui ou non, choisi de vivre en démocratie. Le moins pire des systèmes, mais aussi, parfois, le plus frustrant. Car ici comme ailleurs, c’est l’électorat qui n’a pas laissé le choix aux libéraux et aux centristes qui, la semaine dernière, se sont associés à Geert Wilders. C’est désormais le premier parti du pays, qui occupe 37 des 150 sièges de la Deuxième Chambre néerlandaise (équivalent de la Chambre des Représentants en Belgique et de l’Assemblée nationale en France). Soit un quart des élus.
Un pays de marins perd la boussole.
Politiquement, les Néerlandais de droite sont frustrés. Après treize ans de pouvoir, le libéral Marc Rutte (VVD) a fini par les fatiguer. Scandales, cynisme, et la raison finale de la chute du gouvernement : un désaccord sur le regroupement familial des demandeurs d’asile. La campagne allait donc forcément s’articuler sur les migrations — c’était un des enjeux importants pour 49 % des Néerlandais, et à ce jeu, Wilders partait gagnant.
Un sondage de l’émission de la chaîne publique Éen Vandaag indiquait en novembre 2023 que 8 citoyens sur 10 voulaient qu’on limite le flux de l’immigration, la cause pour beaucoup de la crise du logement devenue endémique dans un pays densément peuplé, et d’une criminalité pourtant globalement en baisse.
Même la gauche, devenue minoritaire, est touchée par le phénomène. Trente-six pour cent des électeurs travaillistes et verts veulent moins d’entrées dans le pays. Ils sont quatre-vingt-cinq pour cent au Socialistische Partij (ex-parti communiste reconverti dans le socialisme républicain et eurosceptique). Et dans la plupart des autres partis, ce chiffre dépasse les 90 %.
Et l’électeur néerlandais semble désemparé. Depuis deux décennies, il se rue facilement sur de nouveaux partis (comme le NSC de Pieter Omtzigt, un ex-chrétien-démocrate, qui obtient 20 député(e)s sur 150 dès sa première participation). Mais il le sanctionne tout aussi sévèrement quelques années plus tard. Comme en Flandre ou en France, les grands partis traditionnels en sortent laminés.
Ainsi, le parti travailliste historique, le PvdA (Parti du Travail), a perdu les trois quarts de ses sièges — de 38 à 9 — en une seule législature (2012-2017). Les chrétiens-démocrates du CDA — autre parti historique qui, trente ans durant, a occupé bon an mal an un tiers des sièges au parlement — sont passés de (déjà seulement) 19 à (un maigrissime) 5 sièges en six ans (2017-2023). Seul le VVD (parti de l’ex-premier Marc Rutte) semble plus ou moins épargné.
Une bombe à fragmentation politique
Aux élections de novembre dernier, le PVV de Geert Wilders a donc emporté 37 sièges. Déjà loin derrière lui, il y a le PvdA-GL, un assemblage des travaillistes (PvdA) et des verts (Groenlinks), avec 25 sièges (17 %). Suivi de près par les libéraux du VVD — le parti de Marc Rutte (24 sièges — 16 %). Puis vient le dernier-né, le Nouveau Contrat Social (NSC) de Pieter Omtzigt (ex-CDA), qui occupe d’emblée 20 sièges ou 13 %. Ensuite, D66 (parti social-libéral) n’est déjà plus qu’à neuf sièges. Et le Mouvement citoyen des Paysans (BBB) en a sept pour sa deuxième participation. Les neuf autres partis sur les quinze (!) qui siègent à la Deuxième Chambre ont cinq députés ou moins !
Corollaire : il faudrait réunir les onze plus petits partis pour égaliser le nombre de sièges de la seule formation de Geert Wilders ! Les calculs sont pas bons, Kevijn !
Certes, les quatre partis derrière le PVV de Wilders disposaient ensemble d’une majorité de 78 sièges et auraient pu proposer une alternative sans le blondinet antimusulman. Mais leurs programmes sont trop divergents. Et en formant un gouvernement sans le premier parti du pays, on risquait de le rendre encore plus puissant et plus incontournable aux élections suivantes. Les électeurs auraient d’autant moins compris qu’on forme une coalition sans le PVV que, ces derniers mois, Geert Wilders (Wilder signifiant « plus sauvage ») avait tellement respectabilisé son discours qu’on l’avait appelé « Geert Milders » (Milder signifie « adouci »).
Logiquement, les partis les plus à droite (VVD, NSC et BBB) étaient donc les plus indiqués pour s’associer au nouveau premier parti néerlandais et fournir au peuple le gouvernement « vraiment de droite » qu’il a plébiscité. Non sans se pincer le nez au VVD et au NSC. Wilders reste imprésentable. En témoigne l’une des conditions qui lui ont été imposées à l’aube de la formation : qu’il ne soit pas lui-même Premier ministre !
Quant au programme présenté, il est tellement radical en matière d’immigration qu’il semble incompatible avec les règles européennes. Le droit au chômage prend des claques. La télé publique voit son budget réduit (Wilders voulait carrément la supprimer). Mais la crèche deviendra gratuite…
Hurler au loup quand il occupe la bergerie
Dès l’annonce de ce nouveau gouvernement, les hurlements habituels ont donc retenti. Alerte ! La tache brune s’étend en Europe ! On revit les pires heures de l’Histoire ! Etcaetera. Les mêmes clameurs qu’on avait déjà entendues lorsque Giorgia Meloni (présidente de Fratelli d’Italia, héritier du Mouvement Social Italien néofasciste) est arrivée au pouvoir en Italie, en 2022, après avoir, elle aussi, lissé son discours.
Mais rappelons-nous que quatre ans plus tôt, les mêmes vociférations avaient accueilli le gouvernement Conte en 2018, qui réunissait le Mouvement populiste Cinq Étoiles et la Ligue du Nord xénophobe. Et qui a oublié les cris d’horreur à chaque déclaration de son ministre de l’Intérieur Matteo Salvini ? Il est pourtant toujours là, mais plus personne ne parle de ses provocations clownesques…
Les mêmes alarmes avaient aussi déjà sonné en 2001, quand Berlusconi a présenté une première coalition qui comprenait non seulement Alleanza Nazionale — l’ancêtre du Fratelli d’Italia de Meloni — mais en plus, les xénophobes régionalistes de la Lega Nord (Ligue du Nord).
Ça fait donc vingt-trois ans qu’on annonce le retour de Mussolini et de ses chemises brunes en Italie. Et vingt-trois ans que la démocratie italienne, elle, est toujours là ! L’une des raisons, c’est peut-être que même les leaders d’extrême droite ont plus à gagner en siégeant dans une assemblée — et donc, en préservant la démocratie représentative — qu’en révolutionnant le système.
On peut par ailleurs espérer que leur volonté de séduire de nouveaux électeurs par un discours moins martial, impose aussi aux partis identitaires de suivre une ligne plus « soft » dans leur gestion, faute de quoi, ils perdraient une partie importante de leur nouveau public aux élections suivantes.
Des mesurettes qui pourraient dériver
Bien sûr, ce n’est pas pour autant rassurant. Car si Meloni est loin de réinstaurer un Duce et tout son tralala nationaliste, les post-néo-fascistes démontent patiemment des mesures progressistes devenues évidentes pour tout démocrate qui se respecte. Meloni n’abolit pas (encore ?) le droit à l’IVG, mais soutient le financement de mouvements « pro-vie ». Elle n’attaque pas (encore ?) directement les LGBT (qui n’ont pas droit au mariage en Italie), mais alimente une ambiance oppressive à leur égard, surtout les parents adoptants. Elle ne détruit pas (encore ?) la justice, mais veut imposer une réforme berlusconiesque qui ne risque pas de l’améliorer.
Dans les faits, elle ne limite même pas (encore ?) drastiquement l’arrivée de migrants, mais impose des amendes aux bateaux de sauvetage et signe des accords douteux avec les pays de départ (Albanie et Tunisie pour l’instant). Ces mesures sont toutefois peu suivies d’effets concrets.
Ainsi, de janvier à mars 2024, 18.593 migrants ont débarqué en Italie, un chiffre comparable à celui du premier trimestre de 2022, avant son arrivée au pouvoir. Bien sûr, le nombre d’entrées n’est pas un critère en soi, puisqu’il dépend du nombre de départs. Néanmoins, sur toute l’année 2023, la première de la législature Meloni, on a compté 157.652 entrées, soit plus que pendant n’importe quelle année de 1990 à 2009. On ne peut donc pas dire que Meloni ait « arrêté » cette immigration qu’elle juge « massive ». Par ailleurs, elle a récemment décidé d’accorder 450.000 titres de séjour. Par réalisme économique : l’Italie se dépeuple. Au Conseil européen, on la dit même « constructive » sur le sujet.
Et malgré cette promesse non tenue d’un arrêt de l’immigration, les Italiens de droite sont contents de Georgette Melons : les sondages placent son parti en tête pour les Européennes, avec près de 27 % des intentions de vote. On peut donc penser que le peuple qui l’a portée n’est pas demandeur d’un retour au fascisme. Il veut simplement être rassuré. Il a besoin qu’on lui dise qu’il ne sera pas dépossédé de lui-même, de ses coutumes et traditions, et il pense manifestement que Giorgia y veille.
Bien entendu, on doit se demander ce qui se passerait si, après plusieurs législatures, Fratelli d’Italia (ou la Lega Nord) obtenait une telle majorité qu’il pourrait gouverner seul. Il en va d’ailleurs de même pour des partis comme LFI ou le PTB en Belgique.
Mais on peut aussi constater que le post-néofascisme est, lui aussi, contraint d’écouter une typologie plus variée d’électeurs. Résultat : elle adopte une ligne politique qui rappelle beaucoup plus la droite des années 70 ou 80 que les régimes des Mussolini, Franco ou Pinochet.
Entre la clameur horrifiée et le constat objectif, il y a donc un gouffre que l’électeur hésitant ne peut pas ne pas remarquer. « ‘On’ me dit qu’avec Meloni, ce sera le fascisme, mais après deux ans je constate que ce n’est pas le cas. Alors, qui ment ? »
Cet électeur répondra de lui-même : les intellectuels, les journalistes, la gauche, etc.
Ce n’est pas comme ça que le progressisme va retrouver des couleurs. Le minimum serait de tenter de comprendre le comportement de l’électeur pour mieux lutter contre ce qui s’apparente désormais plus à un néoconservatisme nationaliste et eurosceptique qu’à un grand soir fasciste. Un retour en arrière, certes. Mais pas celui qu’on dit !
Pour guérir une maladie, il faut d’abord la diagnostiquer correctement.
Peur sur la ville
Tenter de comprendre cette évolution tout en la craignant, dans un but noble — savoir comment réduire le pouvoir de séduction des partis dits d’extrême droite — n’est toutefois pas du goût des « antifas » de gauche radicale, ni même de certains sociaux-démocrates convaincus que l’extrême droite mène systématiquement au totalitarisme et qu’une fois au pouvoir, il n’y a pas de retour en arrière. Et ça, ils tiennent à le prouver. Le programme et l’action de Meloni ne ressemblent pas assez à celui du Duce ? On va donc saisir la moindre occasion pour l’insinuer.
Et c’est là qu’interviennent une poignée d’Italiens qui s’offrent una giornata particolare version Duce. Les antifascistes sincères comme les antifas de posture vont donc, en plus, leur offrir une publicité dont ils salivent d’avance. Et qui ne sert à rien.
Tous les ans, depuis 1979, un à deux milliers de néofascistes italiens commémorent à Rome le « massacre d’Acca Larentia » de 1978, où trois militants d’extrême droite ont été abattus, probablement par l’extrême gauche révolutionnaire.
À Milan, une commémoration similaire a lieu, tous les ans aussi. Celle de l’assassinat de Sergio Ramelli en 1975. Ramelli était un militant du Mouvement Social Italien, âgé de 19 ans, assassiné à coup de clé anglaise par l’extrême gauche parce que — selon l’historiographie néofasciste forcément simpliste —, il avait rendu à son professeur une rédaction hostile aux Brigades rouges. Sa jeunesse et la photo qui en témoigne — celle d’un jeune homme placide aux cheveux longs — rendent ce martyr-là plus poignant encore aux yeux de ses coreligionnaires.
Et depuis bientôt cinq décennies, à la fin de ces cortèges au flambeau, a lieu le rituel des « présents », hérité du culte mussolinien des martyrs. Je vous le fais : après un long moment de silence martial devant la stèle en hommage aux « martyrs », le maître de cérémonie crie « attenti ! » (garde à vous) et scande à trois reprises le nom de la victime (ou « per tutti i cadutti » — pour tous ceux qui sont tombés [au combat]). En réponse, les néofascistes crient « présent ! » en faisant le salut fasciste.
Puis, ils rangent leur main droite dans leur poche qui s’y ankylosera jusqu’à la commémo suivante. Convaincus comme leur crâne glabre d’avoir résisté au bolchévisme, d’avoir honoré de braves personnes, ils rentrent chez eux avec la même discipline.
Voilà bien sûr un folklore dont on se passerait bien. Mais on doit aussi constater que ça fait près de cinquante ans qu’ils font ça, et l’Italie n’est toujours pas redevenue fasciste ! Le vrai problème, celui qui mérite une couverture journalistique sérieuse et des questions parlementaires posées, c’est que, certaines années, on y repère l’une ou l’autre personnalité du gouvernement ou d’un parti de la majorité.
Le bêlement annuel des « antifas ».
Ce presente ! moment si précieux pour les têtes d’œufs souffrant de tendinite du bras droit, l’est tout autant pour les « antifas ». On croirait qu’ils n’attendent que ça pour systématiquement publier des tweets ou des articles annonçant le retour du fascisme dans la botte (d’où l’expression « bruit de botte »). Ou pour s’insurger d’un « Ça ! En 2024 ! Rendez-vous compte ! » Et chaque année, ils recommencent comme si c’était la première fois !
C’est plus grave lorsque des journalistes ou des experts tirent un lien hasardeux entre ces commémos et la présence de Giorgia Meloni à la tête du pays, comme plusieurs journaux l’ont fait, en Italie et ailleurs. En réalité, les néofachos ne l’ont pas attendue pour tendre le bras, être poursuivis, ou même, être acquittés : huit des militants qui l’avaient fait en 2016 ont bien été condamnés en appel en 2022, mais viennent de bénéficier d’un arrêt de la Cour de cassation qui a rappelé que le délit de bras tendu n’existe en Italie que s’il existe un risque réel de refondation « du parti fasciste dissous ».
Or, avec au plus un ou deux milliers de militants présents à ces commémos depuis un demi-siècle, la Cour a estimé que ce risque n’était pas réel.
Quant à Meloni, si l’affaire la gêne évidemment du fait de ses racines néofascistes et de la partie nostalgique de son électorat, les jeunes de son parti ont bien organisé une commémo à part, avec le rite des « présents ». Mais sans les petites mains tendues.
Tout n’est pas réglé pour autant, comme le souligne le journaliste et essayiste Marco Brando sur son blog Il Fatto Quotidiano, parce qu’en janvier de cette année, Giorgia a encore rendu hommage à l’un des fondateurs du MSI — ancêtre de Fratelli d’Italia dont le logo a conservé la flamme centrale —, Giorgio Almirante. Ce monsieur se trouvait être auparavant le secrétaire de rédaction de l’infâme Difesa de la Razza (Défense de la Race), sorte de Rivarol officiel, publié par Mussolini à partir de 1938 pour soutenir le racisme et l’antisémitisme. Marco Brando conclut que le vrai problème, ce ne sont pas les commémos, qui relèvent d’un folklore malodorant, mais bien le fait qu’un personnage comme Almirante soit encore très présent dans la tête de la Présidente du Conseil des Ministres italiens.
L’Anschluss reportée depuis l’an 2000
Autre exemple. En Autriche, en 2017, la coalition des conservateurs (ÖVP) et de l’extrême droite (FPÖ — Parti de la Liberté ; notez la similarité avec le nom du parti de Geert Wilders…) allait presque nous ramener Hitler, à entendre certaines voix affolées. Bon. Elle a duré deux ans. Le Bundestag en est sorti intact. Aux élections suivantes, le Partei perdait vingt de ses cinquante et un sièges.
Un an plus tôt, le candidat du même FPÖ, Norbert Hoffer, avait failli devenir président autrichien, ce qui avait également horrifié l’Europe. Mais après quelques rebondissements et beaucoup de Jodl, c’est le candidat écologiste Alexander Van der Bellen qui a remporté cette fonction essentiellement protocolaire. Il fut ensuite réélu en 2022.
L’épisode le plus révélateur est toutefois la « première » participation (1) du FPÖ au gouvernement autrichien, après la victoire de son leader Jörg Haider, en 2000. À cette époque, le ministre belge des Affaires étrangères Louis Michel (libéral) avait lancé à un journaliste : « Je recommande aux Belges de ne pas aller skier en Autriche. Je pense que ce n’est pas moral. » Jacques Chirac avait entretemps pris la tête de la révolte européenne contre ce retour des bottes dans le pays des Schnitzel, et les quatorze autres États membres de l’Union européenne imposèrent à l’Autriche un boycott diplomatique inédit. No passaran !
Résultat : le FPÖ put abondamment se victimiser. Les Autrichiens conservateurs regimbèrent. Et il ne fallut que quelques mois aux États membres pour se rendre compte, sur base d’un rapport des sages, que la participation de Jorg Haider, tout pourri fût-il, ne mettait pas en danger la démocratie autrichienne. Gag : c’est Jacques Chirac lui-même qui dut se charger d’annoncer la réintégration de l’Autriche dans toutes les réunions européennes…
Grâce à Louis Michel, le pays aura entretemps perdu quelques touristes. Mais aux dernières nouvelles, c’est bien toujours une démocratie !
Le fascisme qui se monte soi-même
On peut aussi citer la Suède, où la victoire récente des Démocrates de Suède a mené à une coalition de droite dont ils ne font pas partie officiellement, mais qu’ils soutiennent depuis le parlement — tout comme Wilders il y a quelques années. On pourrait se dire que c’est peut-être une constante à surveiller : d’abord, on gouverne avec le soutien externe des identitaires qui sentent quand même trop mauvais pour devenir ministres. Quelques années plus tard, on les associe au pouvoir, mais sans leur donner la chancellerie. Et enfin, la troisième étape, c’est l’accession au poste de Premier ministre — en Italie, on y est. Mais c’est toujours une démocratie.
Étrangement, le dirigeant le plus antidémocrate et le plus activement antimigrant d’Europe est probablement Viktor Orban. Premier ministre hongrois de 1998 à 2002 et ensuite, sans discontinuer depuis 2010, soit déjà 18 ans de pouvoir. À son arrivée, point de hurlements. N’était-il pas chrétien-démocrate ?
C’est à se demander si un leader « buvable », adhérant à l’une des trois formations démocrates principales au parlement européen, qui grignote petit à petit les droits constitutionnels et réduit méthodiquement le pluralisme des médias, n’est pas plus dangereux aujourd’hui que ceux qui sont labélisés « extrême droite native » !
La France des lumières branlantes
En France, les souverainistes antimigrants ont aussi le vent en poupe. On leur promet le plus gros score aux Européennes. Il faut dire que, comme ses amis néerlandais, flamands ou italiens, le Rassemblement National a tellement respectabilisé son discours que beaucoup d’électeurs potentiels ne comprennent même plus qu’on le qualifie d’extrême droite. LFI (ou plus généralement la NUPES) a beau « alerter » en confondant France et Franco. Le lepénisme marinier ne fait que grossir depuis des années, irrémédiablement. Selon l’IFOP, 42 % des Français ont déjà voté RN. Ils sont 57 % chez les ouvriers et 49 % chez les salariés.
Les antifas refusent pourtant de reconnaître que leur échec est cuisant et que leurs alertes ne fonctionnent pas. Et pire, ils alimentent le réservoir d’électeurs d’extrême droite. La gauche radicale s’est ainsi évertuée à coller l’étiquette fasciste sur à peu près tout le monde, en particulier, sur les centristes de « la Macronie » (qui ont leurs tares, mais pas celle-là), rendant par proximité imaginaire Le Pen ou Zemmour fréquentables aux yeux de l’électorat, sur le mode : « si l’extrême droite, c’est Manuel Valls, Darmanin ou Macron comme ‘ils’ disent, elle n’est finalement pas aussi dangereuse qu’on dit ». L’électeur s’imagine alors que voter pour la version originale et lepéniste de cette « extrême droite » étendue à tous, apportera enfin un « vrai » changement. À tort. Et c’est là qu’on peut agir : en démontrant que leurs programmes ne fonctionneront pas.
Peut-être les démocrates devraient-ils prendre à bras le corps la question des migrations, qui concerne directement une autre thématique, centrale dans les démocraties, celle de la citoyenneté. Soit le contrat objectif entre l’État de droit et chaque citoyen. L’électeur rebelle se demande pourquoi on exige de lui une rectitude électorale, des impôts, des règles à n’en plus finir, alors qu’il suffirait, selon une légende urbaine, qu’un « migrant » mette un pied sur le territoire pour qu’il bénéficie des mêmes bienfaits.
Le vote d’extrême droite est lié à la peur de la dépossession et le sentiment d’insécurité, souvent exagéré, mais pas toujours (cf. les fusillades à Bruxelles). Les migrations ont un effet concret sur l’insécurité, c’est l’administration néerlandaise qui le dit. Et le sentiment d’insécurité en a un autre sur l’électorat. Il faut donc lui reparler concrètement et non plus agiter des valeurs qu’on n’arrivera jamais à maintenir. L’immigration est un bienfait quand elle est bien pensée et bien gérée. Ce qui a un coût. Et il faut le dire. Et reconnaître que l’argent qu’on investit ici ne peut plus l’être ailleurs. Plus de migration, c’est moins de lutte contre le réchauffement, par exemple. Il est grand temps que les partis démocrates arrêtent de faire croire aux électeurs qu’il suffit de taxer les riches pour tout avoir. Ou que moins les taxer améliorera l’économie.
Mais rien n’est simple : lorsque les démocrates abordent effectivement les migrations, ou la criminalité souvent marginale qui y est liée, c’est souvent l’extrême droite qui l’emporte au final, comme on l’a vu aux Pays-Bas. Parce que, comme le disait Jean-Marie Le Pen : l’électeur préfère le goût du vrai. Et l’extrême droite s’est imposée partout comme le spécialiste de la migration et de la sécurité. L’électeur n’est pas différent du client ou du patient : il va droit au spécialiste.
De la démagogie à la pédagogie
Cela étant, les démocrates ont une responsabilité plus globale, que les partis de gauche en particulier feraient bien de considérer avant de hurler. Ils ont cessé d’expliquer, d’éduquer. Le slogan a pris le pas sur le programme. L’injure et la polémique aussi. Sur les réseaux sociaux, des politiciens crient au raciste, à l’islamophobe, au transphobe, à l’homophobe, au rythme d’une mitrailleuse, hystérisant le discours tout en le rendant d’autant plus confus pour l’électeur lambda.
Pour se convaincre de l’inefficacité totale de ces méthodes, il suffit de constater que ces accusations de racisme en rafale s’accompagnent d’une libération décomplexée de la parole raciste, antisémite, antimusulmane, homophobe, absolument effarante. Cela contribue à rendre la société de plus en plus clivante et même les partis de gestion les plus raisonnables se laissent tirer vers l’une ou l’autre l’extrême.
Or, ce n’est pas en clivant plus qu’on va apaiser la société et tant qu’on ne l’apaise pas, les deux extrêmes vont continuer à proliférer, en se faisant des courtes échelles mutuelles très efficaces. Pour les deux.
Mais si l’on veut vraiment tirer un parallèle avec le nazisme, je rappelle qu’à l’époque de la république de Weimar, les deux extrêmes, gauche et droite, s’y livraient bataille jusque dans la rue. Et là encore, c’est celle qui incarnait l’ordre qui a gagné.
Les vrais problèmes des vrais gens
Enfin, à lire les tweets de certains députés (H/F/X), on se demande s’ils parlent encore du citoyen et de ses problèmes — comme l’exprimait la candidate socialiste française Daphna Poznanski en 2012 : « les vrais problèmes des vrais gens ». L’expression a beau sembler ridicule, elle traduit une réalité : partout en Europe, l’extrême droite est parvenue à faire croire qu’elle allait résoudre ces problèmes. Redresser les pays. Donner plus d’emploi. Quod non, généralement.
C’est peut-être la clé de la vraie solution. Marine Le Pen a brillamment démontré l’irréalisme de ses solutions lors des deux débats présidentiels qui l’ont opposée à Emmanuel Macron, qui s’est patiemment employé à détricoter son programme. C’est donc bien que l’on peut intéresser l’électeur en révélant la vacuité des discours des démagogues en démontrant, interview après interview, son imposture. En confrontant systématiquement les Bardella et compagnie à l’inanité de leurs promesses, et à leur méconnaissance crasse des dossiers, patiemment et implacablement. Mais sans animosité particulière, parce que la virulence ne convainc plus.
Ce serait évidemment plus simple si l’extrême gauche cessait de mettre le feu et si les partis voués à la gestion — toutes orientations confondues — cessaient eux aussi de promettre monts et merveilles, tombant à leur tour dans le populisme des promesses, croyant ainsi battre les extrêmes sur leur propre terrain. I’ve got news for you : ça ne fonctionne pas !
Le nécessaire pouvoir de séduction des démocrates s’émousse dans les surenchères populistes. Elle se niche au contraire dans le réalisme, la pédagogie, le sérieux, la présentation de bilans concrets.
Ou comme le disait le publicitaire David Ogilvy : « dites la vérité, mais rendez-la intéressante ».
Mais comme toujours, il se peut que je me trompe…
(1) En réalité, le FPÖ avait déjà participé à un gouvernement dans les années 80, mais il n’avait pas encore le profil ultranationaliste que lui a ensuite imprimé Jörg Haider.
Tant que vous êtes là…
Cet article est le fruit d’un travail intense de recherche et de rédaction. Vous pouvez me soutenir en faisant un don. Notez qu’en-dessous de 2€, les frais sont prohibitifs.






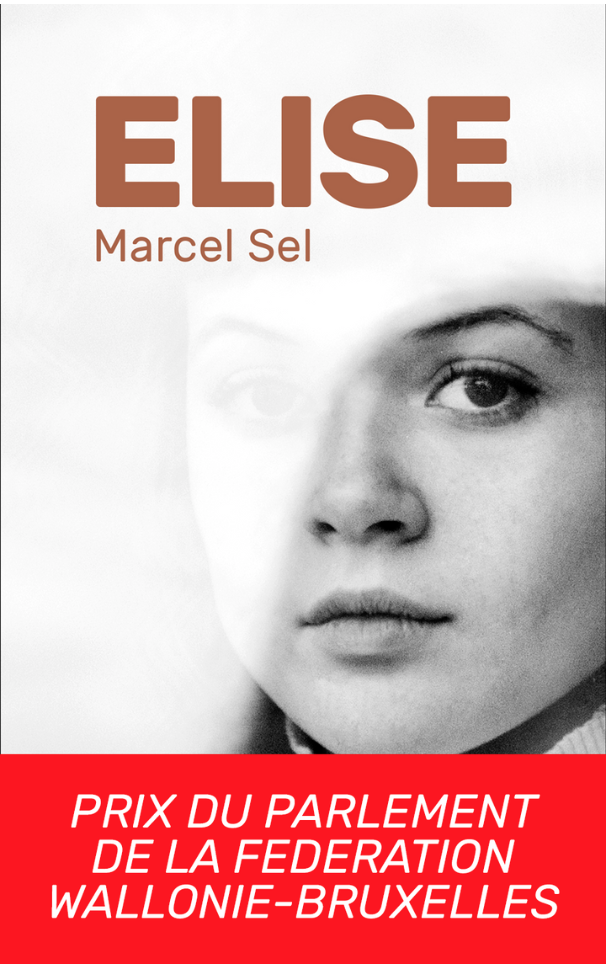
0 Comments
No Comments Yet!
You can be first to comment this post!