James Foley, un témoin. Pas une icône.
Depuis que le journaliste indépendant James Foley a été exécuté face caméra par un membre de l’État Islamique (je préfère ISIS, les deux S donnant plus de corps à l’épouvantable criminalité de cet État), c’est la folie sur les réseaux. Après d’innombrables articles faisant le portrait du malheureux, ma timeline Twitter est désormais envahie de selfies de personnes connues ou moins connues, avec le mot-clé #rememberingjim. Dans le meilleur des cas, ce sont des gens honnêtes qui expriment leur émotion. Dans le pire, c’est Benyamin Netanyahou qui profite de son image à des fins de propagande.
Il y a aujourd’hui une page Facebook et même un site Rememberingjim.org. Cet engouement, si j’ose dire, tient au fait que James Foley était journaliste, apprécié des gens qui l’ont rencontré, et occidental. Pourtant, il me met mal à l’aise. Pour les trois raisons précitées, probablement.
Bien sûr, les journalistes se rendent là-bas pour rendre compte. Ils prennent des risques insensés pour nous informer. Sans cette information, l’opinion publique ne peut exercer son influence sur des États éventuellement réticents à aider militairement voire humanitairement les victimes des atrocités qui y sont commises. Ce sont les articles sur les yézidis chassés, assassinés, bloqués dans une montagne, et les femmes vendues pour 25 dollars, ce sont les alertes lancées par les chrétiens de Mossoul et répercutées par la presse, qui ont — au minimum — contribué à activer l’aide humanitaire et les interventions américaines par drone ainsi que l’assistance d’États européens aux Peshmergas sous des formes diverses. La présence de journalistes est donc indispensable dans un conflit. Ils sont nos seuls points de repère, les seuls lanceurs d’alerte qui aient accès à une médiatisation et qui ne soient pas — en principe — sensibles aux propagandes diverses. Et dans un certain nombre de cas, elle sauve des vies. Sans eux, nous ne saurions pas l’ampleur et la cruauté des exactions de Bachar Al Assad d’abord, de l’ISIS ensuite. Sans eux, nous ne serions pas intéressés au sort horrible de populations entières.
La présence de journalistes en zone de guerre sauve des vies.
Alors, bien sûr, tout ça, c’est important. On a décapité un journaliste. Mais il y a dix jours, Libé publiait un article dans lequel un témoin affirmait que la Waffen-ISIS décapitait des enfants et éventrait des femmes. Sauf que là, nous n’avons pas d’images…
Pour le journaliste Foley, l’ISIS s’est au contraire fendue d’une écœurante mise en scène, décapitant le corps probablement déjà sans vie (d’après des experts en vidéo — je me suis refusé à regarder le clip) d’un compagnon de route très apprécié par ceux qui l’ont connu. La réponse du monde médiatique fut un haut-le-cœur et une condamnation absolue de cette pratique qui fut dès lors qualifiée de « moyenâgeuse ». Pourquoi cette qualification est-elle devenue « unanime » à ce moment-là seulement ? C’était un peu comme si imposer la conversion à des chrétiens sous menace de mort n’était pas suffisamment barbare. Un peu comme si assassiner des enfants sans défense pour le plaisir n’était pas déjà le comble de l’horreur, insurpassable. Ceux-là ont été exécutés pour ce qu’ils sont, des yézidis ou des chrétiens, ce qui est le fondement du génocide ; James Foley est allé là-bas délibérément, connaissant les risques (il avait déjà été enlevé en Libye). Il a été assassiné pour ce qu’il faisait et ce qu’il représentait : un Américain, un journaliste. Il ne serait pas compréhensible que son assassinat passe avant les milliers de meurtres pratiquement rituels dont les victimes sont, si j’ose dire, « encore plus innocentes ».
L’ISIS, lui, a apparemment bien compris comment fonctionne l’Occident médiatique. Vous pouvez tuer 200 hommes à la hache et poster la vidéo sur YouTube, ça ne fera pas la une pour autant. Vous pouvez lapider une femme et la mettre sur Facebook, ce sera une info parmi d’autres. Vous pouvez arracher les yeux des enfants, on publiera le récit des témoins à la page douze. Mais exécutez un journaliste occidental avec un peu de mise en scène, et vous atterrirez à la une, dans les premières secondes du journal télévisé, provoquerez des débats, des commentaires, des chroniques (dont celle-ci, bien sûr). Et dans les heures qui suivront, les conversations sur les réseaux sociaux porteront rapidement sur l’opportunité de diffuser l’exécution, alors que personne ne s’est demandé s’il fallait ou non diffuser les images de têtes coupées de notables locaux ou les corps d’enfants lacérés par un shrapnel à Gaza. Ou la célèbre photo de Huynh Cong « Nick » Ut de cette petite vietnamienne nue et brûlée par une attaque au Napalm en 1972.
Personne n’est anonyme.
On m’a déjà expliqué que ceux-là, c’étaient des anonymes. Or, à ma connaissance, personne n’est anonyme. Tout le monde a une famille. La petite Vietnamienne est devenue grande et a passé des années à tenter de se détacher de cette photo d’elle en victime, en martyre, avant de comprendre que ce cliché a alerté l’opinion publique, et contribué à sauver des vies. C’est cruel, mais le journaliste est sans cesse confronté à ce dilemme : risquer de heurter les proches d’une personne photographiée morte, ou cette personne même au moment où le sort s’est acharnée contre elle, pour rendre compte ; mettre entre parenthèses le droit à l’image quand l’information de la société paraît plus importante. De ce fait, la réponse à la question de la diffusion ne devrait pas dépendre de l’identité d’une personne, mais uniquement de la valeur informative de l’image. Et l’on ne devrait pas voir surgir de campagne (spontanée) lancée par des journalistes incitant à ne pas diffuser la photo de James Foley sur une dune, à genoux, ou toute autre image « parce qu’on connaît la victime ». Il me semble que la liberté éditoriale implique que chaque rédacteur en chef devrait pouvoir décider en son âme et conscience (certains n’en ont pas, et ça ne changera jamais) de l’opportunité de publier telle ou telle image, sans que la profession ne cherche à l’influencer — surtout pas cette profession-là !
Mais « l’engouement » sur Twitter a été d’une rapidité sidérante, et les avertissements qui allaient avec, pareil. La solidarité des journalistes aidant — plus que jamais nécessaire —, chacun y est vite allé de son petit billet en hommage à James Foley. L’interview de quelqu’un qu’il connaissait. La lettre des parents. L’identité du coupable (présumé) et sa photo (de coupable présumé). Rien de ceci n’est anormal ou incompréhensible, bien sûr. Mais il y a une limite. Quand l’enquête sur « qui a tué James Foley » prend le pas sur le viol et le meurtre de masse de jeunes femmes, on dérape déjà. Quand on crée une page pour lui rendre hommage et qu’on lance une campagne de « soutien » sur les réseaux, on dépasse les bornes. En faire un Che Guevara, un Gandhi du reportage de guerre n’a pas de sens.
Ne pas se laisser impressionner par les circonstances de sa mort.
Car tout d’abord, des journalistes sont tués tous les jours dans le monde, et leurs photos sont rarement diffusées. Pourquoi lui, plutôt que cent autres ? Ensuite, parce que cette exagération ne sert pas la cause que James lui-même défendait en pratiquant son métier. Enfin, parce que ce faisant, on reconnaît implicitement son assassinat comme un événement hors normes, ce que, justement, ses assassins ont recherché. La mort de James Foley est un épisode de la vie de James Foley, de l’histoire du journalisme, et la revendication de l’ISIS est sans intérêt dans ce contexte. Se laisser impressionner par les circonstances de sa mort parce qu’elle était « cinématographiquement horrible » revient à reconnaître à son bourreau et à son exécution un caractère exceptionnel. Un journaliste est mort, point. Vous comprendrez que pour ma part, la réponse à la question « fallait-il diffuser l’image pour illustrer l’info » est « non ». Mais en toute indépendance, et après mûre réflexion.
Une fois que les rédactions ont publié les points fondamentaux de cette affaire — à savoir, d’abord, que l’assassinat de journalistes sert à décourager la présence de la presse dans une région donnée, pour s’autoriser ensuite à massacrer du civil et de l’innocent, de la grand-mère et de l’enfant, en toute tranquillité (et le rappel sur la nécessité du reportage et de la présence des médias) ; ensuite, que le journaliste a été enlevé et tué parce qu’il était journaliste, ce qui autorise bien entendu qu’on reconnaisse son courage et qu’on lui rende hommage — il faut aussi savoir s’arrêter et résister à ce qui nous fait tomber dans le corporatisme : il est tombé au champ d’honneur, mais pas plus. Rappelons ce que cela implique, commémorons-le comme il le mérite, et ensuite, n’inondons pas nos colonnes de sa photo, des innombrables hommages qui lui sont rendus, parce que justement, son engagement était de rendre compte des milliers de victimes de l’horreur syrienne et de la barbarie de l’ISIS, pas qu’on focalise sur lui ! Le journaliste est d’abord un témoin. Lui rendre justice, rendre justice aux milliers de correspondants de guerre tués et blessés, c’est aussi en faire le moins possible, s’arrêter à temps, pour regarder dans la même direction que lui, et reprendre le plus vite possible le compte-rendu des massacres qu’il aurait certainement, s’il n’avait pas été fait prisonnier et tué ensuite, contribué à médiatiser.
C’est parmi les victimes qu’ils défendent avec leurs armes pacifiques, que les reporters ou correspondants de guerre tués en faisant leur métier, ont leur place. Pas à leur tête, encore moins à leur détriment.







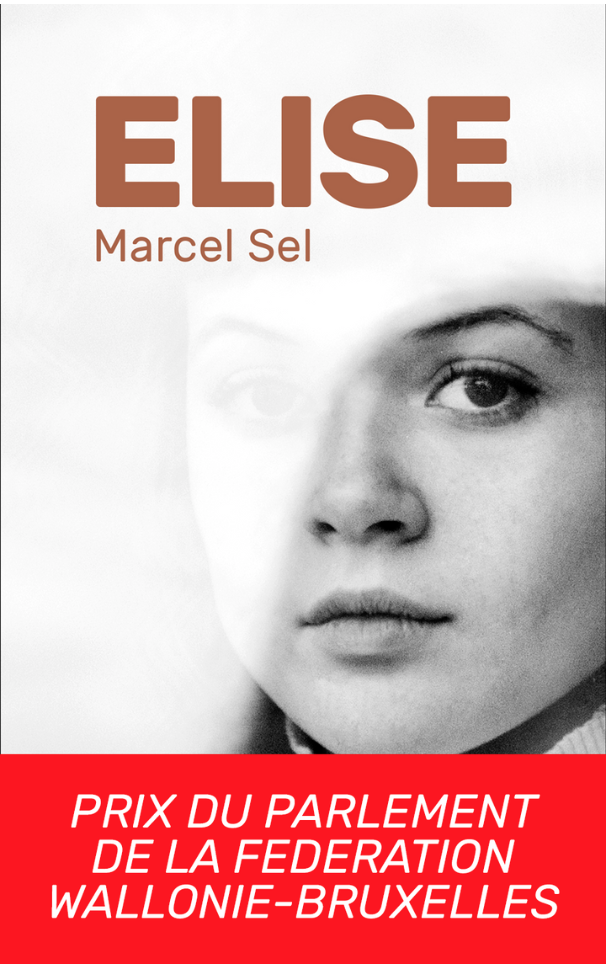
0 Comments
Tournaisien
août 25, 22:02Tournaisien
août 26, 07:35Pfff
septembre 04, 15:16uit 't zuiltje
septembre 05, 21:10uit 't zuiltje
août 27, 16:43Tournaisien
septembre 01, 15:46Pfff
septembre 05, 16:22uit't zuiltje
septembre 10, 17:36uit 't zuiltje
septembre 05, 21:04L'enfoiré
août 28, 14:25Capucine
août 30, 19:38Valerie Chaste
octobre 22, 22:12Marcel Sel
octobre 23, 23:26Valérie Chaste
décembre 28, 16:09Valérie Chaste
décembre 28, 16:11